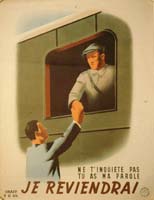
LE S.T.O. (Service du travail obligatoire)
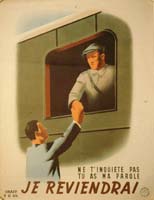
A la fin de l'année 1942, Hitler
mène une guerre totale qui engage l'ensemble de l'économie Allemande,
transformée en économie de guerre. Les usines d'armement fonctionnent 24h/24h et
ont besoin de beaucoup de main d'oeuvre. Dans un premier temps cette main
d'oeuvre sera constituée par des Polonais, des Russes et des Tchèques. En 1941
se met en place en Norvège une forme de travail obligatoire.
En 1942 les nazis réclament à la Belgique et à la France des ouvriers qualifiés.
En mars 1942, Fritz Sauckel, qui est alors un important représentant nazi est
nommé responsable du recrutement et de l'emploi de la main d'oeuvre. Après avoir
imposé à la France une forte contribution de guerre destinée aux troupes
d'occupation, et une réquisition de la majeure partie de sa production
industrielle et agricole, les nazis réclament désormais une force de travail.
Dans un premier temps cette main d'oeuvre est constituée de prisonniers de
guerre, puis de volontaires, auxquels les services de propagande proposent de
bons salaires et une bonne nourriture. La majeure partie des Français
connaissent alors des restrictions alimentaires. En juin 1942, Sauckel se rend à
Vichy et impose à Laval le recrutement forcé de 350 000 travailleurs. A la fin
du mois de juin est annoncée à la radio la création de la "relève". Pour trois
volontaires envoyés dans les usines Allemandes, les autorités nazies libéreront
un prisonnier de guerre. Le premier train de "relevés" est accueilli le 11 août
1942 par Laval.
Mais le nombre de prisonniers libérés par les Allemands est en-dessous des
promesses. Le nombre des travailleurs Français partant pour l'Allemagne est lui
aussi inférieur aux prévisions. A la fin de l'année 1942 ils sont seulement 240
000. Les autorités Allemandes et Françaises vont alors organiser un recensement
général des travailleurs Français et vont imposer à tous les inactifs de trouver
un emploi. Les usines Françaises les moins rentables sont fermées par les nazis
ce qui rend disponibles de nombreux travailleurs. A la fin de l'année 1942 un
décret de Sauckel concernant la zone occupée lance le principe du travail
obligatoire. Cette mesure est presque aussitôt suivie par un décret de Laval
destiné à la France de Vichy qui sera occupée le 11 novembre 1942 par les
Allemands. Les ouvriers Français qui ne travaillent pas directement pour
l'Allemagne peuvent être recrutés par les autorités préfectorales et envoyés en
Allemagne par train spécial. Cette décision a été prise le 1er février 1943 et
concerne toutes les femmes sans enfants de 18 à 45 ans et tous les hommes de 16
à 60 ans. Le 16 février une loi impose le Service du Travail Obligatoire(STO).
Tous les jeunes gens âgés de 20 à 22 ans peuvent être envoyés de force en
Allemagne. En juin 1943 Sauckel réclamera 220 000 hommes, puis en août 1943 500
000. Plus tard il en exigera 1 000 000.
La France est le pays qui a fourni la main d'oeuvre la plus importante à
l'économie de guerre du IIIème Reich : 400 000 travailleurs volontaires, 650 000
requis au titre du STO et près de 1 000 000 de prisonniers de guerre et un
million de travailleurs employés par les entreprises Françaises produisant
exclusivement pour l'Allemagne. Au total cela fait environ 3 000 000 de
personnes. Les requis du STO étaient payés. A la Libération ils seront reconnus
comme des "déportés du travail". Le STO a poussé un grand nombre de jeunes à
rejoindre les maquis. Cependant certains ont choisi de s'engager dans la Milice
ou dans la Légion des Volontaires Français(LVF), créée en 1941 pour lutter
contre le "bolchevisme".
La propagande Allemande pour
le STO
Service du travail obligatoire en Allemagne ou pour l'Allemagne

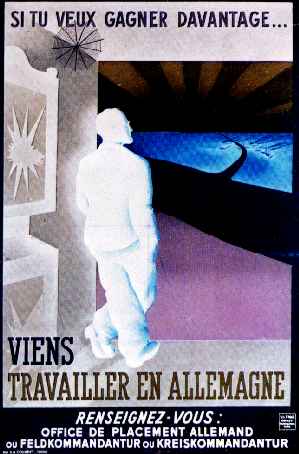
Les revendications des victimes du STO
Question (n° 100 898) de Mme Claude DARCIAUX (PS, Côte d'Or) publiée au Journal
officiel le 25 juillet 2006 avec une réponse du ministre délégué aux Anciens
Combattants publiée au JO le 5 septembre 2006.
05/09/2006
Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention du ministre délégué aux anciens
combattants sur la situation de l'ensemble des personnes requises en Allemagne,
dans le cadre du service du travail obligatoire, lors de la Seconde Guerre
mondiale.
Ces hommes ont été contraints à servir l'occupant nazi, pour certains, en toute
bonne foi, espérant ainsi apporter aux familles de prisonniers de guerre
français le soulagement de voir rentrer l'un des leurs par cet échange. Les
conditions particulières dans lesquelles ont eu lieu ces réquisitions, la
précarité des conditions qu'ils ont pu être amenés à rencontrer en Allemagne ont
parfois conduit à fragiliser, tant physiquement que psychologiquement, les
personnes revenues de ce service obligatoire.
Aujourd'hui, pourtant, ils ne disposent pas de la carte officielle reconnaissant
leur qualité de victime du travail forcé. La loi n° 51-538 du 14 mai 1951
codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires et
d'invalidité des victimes de la guerre a certes institué le statut de personne
contrainte au travail en pays ennemi, mais l'arrêté fixant les caractéristiques
de la carte n'a jamais été pris, si bien qu'ils ne reçoivent qu'une attestation
provisoire dite « T. 11 ».
La France se doit, comme elle a su le faire pour l'ensemble des personnes ayant
eu à subir un préjudice, de quelque nature que ce soit, en raison de
l'occupation nazie et des actes de barbarie commis, d'apporter la reconnaissance
à laquelle légitimement peuvent prétendre ceux qui ont été requis, déplacés et
privés de liberté. Aussi madame Darciaux demande au ministre délégué quelle
mesure il compte prendre afin que l'attestation provisoire reçue par les
personnes concernées puisse devenir une carte définitive portant reconnaissance
du caractère de victime des hommes et des femmes « raflés » dans le cadre du STO.
Elle lui demande également de lui préciser le calendrier qu'il compte mettre en
oeuvre afin que puisse être définitivement arrêtée cette mesure.
Hamlaoui Mekachera : Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la loi n°
51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivant du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le
statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment,
des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en
Allemagne. Dans ce cadre, les articles L. 317 et R. 373 et suivants de ce code
prévoient de délivrer aux bénéficiaires du statut une carte dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté.
Cependant, dans un contexte de différends apparus entre les associations de
déportés et celles regroupant les travailleurs contraints, le projet d'arrêté
nécessaire n'a pu être élaboré jusqu'à présent en l'absence d'accord sur le
titre de la carte officielle. Cette situation n'affecte néanmoins en rien les
droits que les intéressés détiennent en raison du statut spécifiquement créé à
leur intention. C'est ainsi que l'attestation qui leur est délivrée en
application de l'article R. 384 du code précité leur permet de bénéficier de
tous les droits et avantages définis par le code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire, pour ce qui concerne
leurs infirmités imputables à la période de contrainte au travail, des droits à
pension reconnus par la législation aux victimes civiles de la guerre 1939-1945
; de la qualité de victimes de guerre et de tous les avantages d'ordre social
dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
que celle-ci confère ; de droits à la rééducation professionnelle et à
l'admission aux emplois réservés ; enfin, de la validation de la période de
contrainte, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement
et pour la retraite, au même titre que le service militaire en temps de paix.
Le Premier ministre (ndlr : Jean-Pierre Raffarin) a en outre marqué, le 8 mai
2005, lors de la cérémonie du 60e anniversaire du retour des prisonniers de
guerre et des requis du STO, devant l'ancienne gare d'Orsay à Paris, le respect
et la reconnaissance dus par la nation devant le sacrifice forcé d'une partie de
la jeunesse qui, victime de cette loi inique, a cependant su exprimer son
indéfectible patriotisme par les sabotages nombreux et la résistance passive
destinés à contrarier l'effort de guerre de l'ennemi.