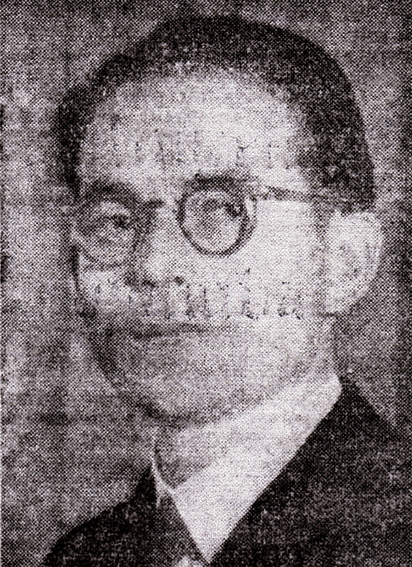
Le Pasteur Fricker
Charles Fricker est né le 10 avril 1910 à Paris. Il a été nommé pasteur à TIEFFENBACH de 1935 à 1945.
Durant la seconde guerre mondiale il faisait partie du maquis de Volksberg (voir ci-dessous)
En 1947 il reçu la « Medal of Freedom » des Américains qui est l’équivalent de la Légion d’Honneur en France
Le maquis de Volksberg
(Extrait de « La seconde guerre mondiale en Alsace Bossue » de Sophie Maurer
Volksberg, autant par sa situation géographique que par l’esprit de ses habitants, était un lieu privilégié pour devenir un centre de résistance à l’occupant.
Situé dans un creux de plateau de l’Alsace Bossue, à l’écart de toute voie de communication importante, sur une route secondaire ne desservant que les deux villages de Weislingen et de Volksberg et entouré de vastes forêts qui permettaient de passer discrètement en France, par les Vosges ou la Lorraine, le village ne présentait aucun intérêt stratégique.
Après la débâcle de 1940 s’y créa un flux d’évasion de soldats français qui avaient réussi à s’évader des camps de prisonniers ou à ne pas se faire prendre sur la ligne Maginot, située à 15 kilomètres au nord du village. Ils venaient frapper aux portes des villageois qui les aidaient selon les moyens dont ils disposaient, tantôt en leur fournissant de la nourriture, des habits, tantôt en leur expliquant le chemin à suivre.
Avec l’extension de la guerre en Russie et l’instauration du travail obligatoire en
Allemagne pour les jeunes Français, beaucoup de réfractaires s’étaient fait connaître, et la résistance à Volksberg prit d’autres formes.
Les "partisans", comme on les appelait au village devenaient de plus en plus nombreux dans les forêts aux alentours. Le moment était venu pour songer à organiser la vie de toute cette armée de l’ombre, afin d’empêcher tout brigandage et préparer une résistance.
Plusieurs vols, pillages avaient en effet eut lieu dans les villages limitrophes, par des hommes dépités, qui ne se sentaient pas soutenus ou qui étaient traqués.
Tout ceci incita des groupes structurés ou "sauvages" à s’organiser dans les profondeurs de la forêt, dans laquelle il ne faisait pas bon s’aventurer.
On se racontait dans le village et dans les alentours, - pour être sûr que tout le monde serait au courant – des légendes terrifiantes sur ces bois, pour éviter la venue des gendarmes en ces lieux, et cela leur réussissait. Les gendarmes allemands ne venaient pas trop souvent et on leur racontait l’existence de terroristes dans la forêt afin de les apeurer et ils ne voulaient en aucun cas savoir ce qui s’y passait.
Le pasteur Fricker de Tieffenbach créa dans les villages un réseau clandestin constitué d’hommes qu’il jugeait "sûrs" et qui pouvaient servir de passeurs, d’agents de liaison, capables de fournir de la nourriture et de cacher les évadés ou prisonniers susceptibles de passer dans ces forêts.
Un autre atout favorable à cette résistance : en 1940 avaient été abandonnés dans la forêt des dépôts de munition et des armes qui furent récupérés avant que les Allemands puissent mettre la main dessus.
La véritable cellule de résistance mise en place à Volksberg était dirigée par le pasteur Bastian en poste dans la localité, et était un véritable réseau secret. Ses membres étaient désignés par des pseudonymes et utilisaient des signes de reconnaissance et de ralliement secrets.
S’il s’agissait de soldats en permission ne voulant plus retourner en guerre, leur méthode consistait à faire exécuter au jeune évadé en question ses adieux à sa famille et ses amis, comme s’il partait réellement, et tout ceci à l’insu de leur famille ; celle-ci attirant sur elle des représailles (menaces de déportation) si la Gestapo venait à les soupçonner de complicité. Puis le soir, il se rendait à la gare pour prendre le dernier train, montrant sa permission ou son titre de transport et descendait à contre -voie à la gare suivante en disparaissant dans la nuit.
Pour l’organisation pratique du maquis, le pasteur Bastian a pu compter sur l’aide de
François Jaming, surnommé "Emile", ancien mobilisé dans l’armée allemande et cuisinier en Yougoslavie.
Le jour il cuisinait et la nuit il rejoignait les partisans de Tito. Puis, comme la plupart l’ont fait, rentré en permission, il n’était plus reparti et aida le pasteur Bastian.
Ils étaient aidés par le pasteur Fricker, par lequel ils se procuraient de l’argent pour acheter le bétail, le garde-forestier du village leur fournissait du gibier et le boulanger du village cuisait de grosses boules de pain.
Les paysans "oubliaient" volontairement des paniers de légume ou des sacs de pommes de terre au coin d’un champ et le lendemain, ils les retrouvaient vides. Ainsi, tout le monde participait dans la mesure de ses moyens, et c’est ceci qui a fait de Volksberg un village à part, car tous les habitants se battaient pour la même cause, sans vraiment se soucier de ce qui pouvait leur arriver.
Pour l’habitat, Emile se chargeait de construire des abris souterrains particulièrement invisibles, cachés par des petits sapins ou des plaques de mousses et une trappe, par laquelle émergeaient des groupes de six à huit hommes.
Ainsi les "partisans" vivaient dans ces abris souterrains, creusés dans la terre, renforcés par des rondins de sapin et couverts de terre et de toute sorte de végétation naturelle. A l’intérieur, on y trouvait des lits superposés, une cuisinière, un tuyau d’aération, des garde-mangers et des caches d’armes.
La plupart de ces habitations étaient implantées du côté de la maison forestière de
Volksberg, sur la route qui mène au Speckbronn. D’autres étaient éparpillées un peu partout près du village.
La composition du maquis était hétéroclite : on y trouvait aussi bien des Russes, des
Polonais, que des Serbes ou des Français, venus pour une raison ou une autre qui les opposait au régime nazi. Certains restèrent près de 18 mois, d’autres n’étaient que de passage.
Leur itinéraire se faisait ainsi : ils suivirent la ligne de haute-tension en pleine forêt, venant de Goetzenbruck et débouchant à l’est de Volksberg pour rejoindre à côté de Weislingen la vallée de l’Eichel. De là, après l a voie ferrée entre Durstel et Asswiller, les fils électriques les dirigeaient vers le sud, où ils pouvaient rejoindre Sarrebourg ; le plus souvent par le train de la ligne Diemeringen-Sarrebourg.
Le réseau était bien organisé et était devenu très sûr. En effet, toutes précautions étaient prises pour ne pas tomber entre les mains des nazis.
Ces derniers quant à eux étaient aussi bien organisés. Des miliciens français se faisaient passer pour des prisonniers évadés et se rendaient dans les campagnes, en frappant aux portes pour demander à manger ou de quoi se cacher. Et puis, un autobus de la Gestapo venait cueillir le lendemain tous ceux qui avaient pu les aider. Mais le pasteur Bastian, au courant de ces leurres, avant de faire « passer » un nouvel arrivant, veillait à récolter toute information sur celui-ci. Un seul habitant se fit prendre à Volksberg par un de ces traîtres.
D’autres villageois ont préféré se réfugier au moulin de Volksberg, tout au long de l’occupation pour éviter tout contact avec les Allemands.
Tout se déroulait bien jusqu’aux premiers jours d’octobre 1944. Un de ces "évadés" s’était aventuré dans la forêt et tomba sur un groupe creusant un abri. La consigne était formelle : "Tout individu s’introduisant dans le maquis sans raison, était à exécuter."Ce dernier fut arrêté et le pasteur Bastian, qui de par sa fonction ne put le condamner, le fit simplement surveiller ; ce qui s’avéra fatal, puisqu’il parvint à s’échapper.
Ainsi, dans la nuit du 11 au 12 octobre, un bataillon de SS débarqua au hameau du
"Speckbronn", s’infiltra dans la forêt en se dirigeant tout droit sur le lieu où l’espion avait été retenu. Les occupants ne s’y attendant pas furent cernés. Une fusillade s’engagea ; un lieutenant polonais fut tué. Les autres parvinrent à s’échapper dans les bois, alors que certains Russes se laissèrent arrêter sans résister. Les prisonniers au nombre de six furent emmenés à Oermingen le lendemain.
Le pasteur, se trouvant au village les vits passés dans un camion découvert, un des détenus baissa les yeux, et Bastian comprit que son tour d’être arrêté viendrait bientôt. Un abri, préparé par Emile l’attendait dans le maquis, mais il préféra rester auprès de sa femme, et en se laissant arrêter, il pouvait éviter une avalanche d’arrestations dans le village.
L’évadé qui avait détourné son regard était en fait un milicien, complice des Allemands, surnommé "Chardon" et qui avait su gagner la confiance de son entourage et ainsi infiltrer le réseau. Ce fut non seulement le seul qui y parvint, mais aussi un des seuls connaissant les identités de "Capitaine Henri" (Fricker) et de "Monsieur Charles" (Bastian).
Le 16 octobre 1944, les issues des villages de Tieffenbach et Volksberg furent bloquées par un commando de SS et les presbytères furent cernés. Monsieur Fricker fut confronté à "Chardon" à Tieffenbach, de même que le pasteur Bastian à Volksberg. Le complice allemand n’hésita pas à les dénoncer.
Ils furent enfermés au camp de Schirmeck avec leurs épouses, ainsi que d’autres personnes soupçonnées de faire parti du réseau. Emile eut le temps de disparaître dans une grange sous le foin. Le réseau, du moins ce qu’il en restait, s’organisait tant bien que mal dans le seul but de survivre.
La Gestapo avait fini par apprendre par les prisonniers, qu’il existait un "Simon", bien sûr un "Emile", un "Jacques", mais aussi un "Dédé" et bien d’autres personnages fantaisistes pour brouiller les pistes. L’ennemi ne retourna pas dans la forêt pour voir ; d’ailleurs quelques semaines plus tard, ce fut la libération de l’Alsace et l’arrivée des Américains à Volksberg.
Le pasteur Bastian revint du camp, au lendemain de l’Armistice du 8 mai 1945 et se rendit à Volksberg, où il termina l’année, avant de s’installer à Lingolsheim. Il fut décoré de la Légion d’Honneur en 1970.